Un film de Bong Joon-Ho
Résumé
En 1986, dans la province de Gyunggi, le corps d’une jeune femme violée puis assassinée est retrouvé dans la campagne. Deux mois plus tard, d’autres crimes similaires ont lieu. Dans un pays qui n’a jamais connu de telles atrocités, la rumeur d’actes commis par un serial killer grandit de jour en jour. Une unité spéciale de la police est ainsi créée dans la région afin de trouver rapidement le coupable. Elle est placée sous les ordres d’un policier local et d’un détective spécialement envoyé de Séoul à sa demande. Devant l’absence de preuves concrètes, les deux hommes sombrent peu à peu dans le doute…
Seven up‘
Genre cinématographique par excellence, le film policier a traversé l’histoire du cinéma, se faisant bien souvent le reflet de son époque. Certains thrillers s’avèrent même être des classiques du 7ème art, bouleversant les codes narratifs et visuels tout en offrant un regard acéré sur la société. C’est le cas de Memories of Murder de Bong Joon-ho qui, dix ans après Seven de David Fincher, rebat les cartes du genre.
Inspiré d’une affaire criminelle réelle, le film plonge le spectateur dans la Corée du Sud des années 1980, à une époque ou le pays est étouffé par la dictature militaire, la censure et une méfiance généralisée envers les institutions. Une toile de fond qu’utilise intelligemment Bong Joon-ho pour dresser le portrait accablant de la police coréenne, minée par l’incompétence et des méthodes archaïques. L’impuissance des enquêteurs, perdus dans un labyrinthe de fausses pistes et de détours narratifs, reflète finalement celle d’une société entière, écrasée par un régime oppressif.
À travers une mise en scène aussi précise qu’audacieuse, le cinéaste défie les lois du genre, en mêlant burlesque et tragédie, comédie et horreur. Loin de se contenter d’installer une tension pesante, il la dynamite de l’intérieur avec un humour absurde, parfois dérangeant. Ce mélange n’est pas un simple contrepoint mais devient un outil dramatique essentiel, maintenant le spectateur dans un équilibre précaire où le rire se transforme soudain en malaise. Le réalisateur joue avec les codes du thriller, du mélodrame, voire du pamphlet politique, pour mieux les subvertir et construit un engrenage où l’horreur s’infiltre progressivement.
Davantage qu’un film sur une affaire criminelle, Memories of murder est une œuvre hybride, à la fois enquête sociale, satire mordante et drame politique. Bong Joon-ho y explore ses thèmes de prédilection (échec des autorités, chaos social, traumatismes collectifs), orchestrant une plongée vertigineuse dans les failles de la société Coréenne. Magistral !
Fiche technique
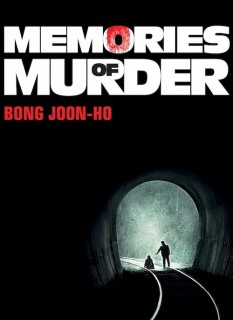
- Titre original : 살인의 추억 (Salinui chueok)
- Durée : 2h12
- Réalisateur : Bong Joon-Ho
- Pays d’origine : Corée du Sud
- Distribution : Song Kang-Ho – Kim Sang-Kyeong – Song Jae-Ho
- Date de sortie : 2004
- Genre : Thriller
Plan culte
Séance: Mardi 16 septembre à 19h30 (Cinéma Artplexe)

La critique du Poulpe (par Séraphin)
Mémoires polarisantes
Bong Joon-ho n’a jamais été un cinéaste de la résolution, mais plutôt de l’inachèvement. Memories of Murder, son deuxième long-métrage, illustre de manière radicale ce refus de la clôture : le film ne propose ni coupable certain, ni justice réparatrice, ni vérité consolatrice. Il met en scène un pays – la Corée du Sud des années 1980 – où la vérité est à la fois recherchée et toujours déjà compromise, où chaque tentative d’élucidation se brise sur les structures sociales et politiques d’un régime autoritaire, militarisé, obsédé par l’ordre apparent mais aveugle au désordre réel.
Les policiers sont caricaturaux, grotesques, souvent ridicules : brutalité gratuite, recours à la torture comme méthode d’enquête, confiance aveugle en des preuves absurdes (l’empreinte de bottes, le visage d’un suspect « qui a l’air coupable »). Cette absurdité n’est pas une simple critique de l’incompétence : elle est une parabole politique. Dans une Corée des années 80 encore sous loi martiale, où les protestations étudiantes étaient écrasées à coups de matraques, l’institution policière n’apparaît pas comme garante de la justice mais comme une machine de répression et de diversion.

On nous montre comment l’État détourne ses forces de l’essentiel : plutôt que de protéger les citoyens contre un tueur en série, il déploie ses forces contre les manifestants démocrates. Le spectateur assiste à un scandale latent : le crime individuel est secondaire par rapport au crime institutionnel.
Philosophiquement, le film questionne la possibilité même de connaître. Chaque piste semble prometteuse, chaque suspect paraît crédible, mais rien ne tient. Le réel échappe. Ce motif rejoint une réflexion épistémologique : qu’est-ce que « savoir » dans un monde saturé par la peur, la violence et la manipulation politique ?
L’inspecteur Seo, figure du policier « rationnel », n’est pas plus efficace que Park, caricature de l’intuition maladroite. La science (les analyses ADN envoyées aux États-Unis) se révèle aussi vaine que la superstition ou le flair. Bong Joon-ho interroge ici l’illusion de la modernité : croire que le progrès technique suffira à faire jaillir la vérité. Il est démontré que la vérité n’est pas seulement une question de moyens, mais aussi de structures : sans institutions justes, sans État responsable, aucune enquête ne peut aboutir.

L’un des choix les plus radicaux de Bong réside dans l’indétermination du coupable. Dans le plan final, le détective Park regarde la caméra : il brise la frontière entre fiction et spectateur. Ce n’est pas le criminel qui est exposé, c’est nous. Le film suggère que le mal n’est pas une figure singulière à éradiquer, mais un fond diffus qui circule dans la société. Le meurtrier n’est qu’un symptôme : l’horreur réside dans l’incapacité de la société à lui opposer autre chose que la confusion, la violence et l’oubli.
Ce geste final a une portée philosophique : il met en scène le concept d’« abîme » cher à Nietzsche : lorsqu’on cherche trop longtemps le mal, c’est lui qui finit par nous regarder. Park, devenu « normal » dans sa vie civile, se retrouve hanté par l’absence de vérité, par la présence spectrale d’un mal jamais nommé.

Le titre du film ne renvoie pas seulement aux souvenirs des enquêteurs, mais à la mémoire nationale. Ces crimes sont emblématiques d’une époque où le pays, tout en se modernisant économiquement, restait politiquement étouffé. En ce sens, Memories of Murder rejoint la question philosophique de Paul Ricœur : comment une société se souvient-elle de ses blessures, et que fait-elle des zones d’ombre de son histoire ?
La Corée du Sud des années 2000, qui redécouvrait ces crimes non résolus, voyait dans ce film le miroir d’une mémoire incomplète : le traumatisme n’était pas seulement celui des familles des victimes, mais celui d’une nation incapable de mettre un visage sur son propre passé. L’« archive manquante » devient une métaphore de la démocratie coréenne : un édifice construit sur des silences, des trous, des non-dits.

Enfin, le réalisateur n’oublie jamais l’humour. Les chutes, les bagarres absurdes, les quiproquos policiers provoquent un rire nerveux. Cet humour noir est une arme critique : il empêche le spectateur de s’installer dans une posture de pure terreur ou de pur pathos. C’est la logique du grotesque : révéler la faillite d’un système en exposant son ridicule. Philosophiquement, c’est une arme subversive proche de la pensée de Bakhtine, pour qui le rire dévoile ce que le pouvoir voudrait cacher.
Memories of Murder n’est pas seulement un polar inspiré de faits réels, c’est une méditation politique et philosophique sur le vide. Le vide des institutions, le vide de la vérité, le vide que laisse un crime sans coupable. En refusant la résolution, Bong oblige le spectateur à habiter ce manque, à éprouver l’inquiétante étrangeté d’une société où l’État est incapable d’assurer la justice.
En ce sens, le film est moins une enquête sur un meurtrier qu’une enquête sur la Corée elle-même, sur sa mémoire et sur ses zones d’ombre. Bong Joon-ho n’offre pas une réponse, mais un miroir : et c’est ce miroir, tendu vers nous dans le dernier plan, qui nous renvoie la question la plus politique et la plus philosophique qui soit : que faisons-nous, individuellement et collectivement, face à l’absence de vérité ?





Laisser un commentaire